Vincent Liegey est ingénieur et militant de la décroissance. Il travaille à Budapest en Hongrie sur un projet coopératif et citoyen Cargonomia autour de la sobriété et de la décroissance. Avec la journaliste Isabelle Brokman, Vincent Liegey a tiré de son expérience un livre Sobriété (la vraie) aux édition Tana. À la fois guide pratique et réflexion, cet ouvrage a donné l’occasion à GoodPlanet Mag’ de s’entretenir de la sobriété avec Vincent Liegey.
Qu’est-ce que la vraie sobriété ?
La vraie sobriété est exactement celle dont on ne parle pas depuis que le gouvernement et Emmanuel Macron se sont emparés du terme à la fin de l’été 2022. Le livre, dont le titre est un peu provocateur, cherche à revenir aux fondamentaux de cette belle notion.
La sobriété s’avère une idée ancienne commune à de nombreuses civilisations. La sobriété consiste à s’auto-imposer des limites. Elle se rapproche de la tempérance. De nombreuses sociétés ont compris que si on ne sait pas s’imposer des limites, on ignore comment être libre et heureux.
« La sobriété consiste à s’auto-imposer des limites. »
Or, aujourd’hui en dépit d’une opulence sans égale dans l’histoire de l’humanité, nous visons dans des sociétés de surabondance frustrée qu’entretiennent les imaginaires développés par la croissance, la publicité et le consumérisme.
[À lire aussi Les insuffisances des appels à la sobriété du gouvernement, selon Greenpeace]
La sobriété appelle donc à faire moins pour vivre plus heureux. Il reste encore à définir individuellement et collectivement ce qu’on met derrière ce moins.
Pourquoi ce guide sur le sujet ?
Avec Isabelle Brokman, nous voulions expliquer pourquoi un projet de sobriété ne marche pas sans une refonte de nos modèles économiques et de nos imaginaires.
« Si on ne sait pas s’imposer des limites, on ignore comment être libre et heureux. »
La sobriété ne peut pas s’envisager dans une société de croissance, où elle aboutit en général à une récession et des problèmes sociaux. Elle implique de revoir nos imaginaires, et plus particulièrement la place de la publicité. Son omniprésence dans les médias et sur les réseaux sociaux véhicule une vision de la réussite basée sur la consommation. Alors qu’il arrive que dans le même temps, les médias expliquent la gravité des crises écologiques et sociales engendrées par la croissance. On se retrouve face à des incantations contradictoires. Il faut donc bien définir ce qu’on entend par sobriété. C’est faire moins afin d’arriver à faire mieux pour mieux vivre grâce à plus de convivialité et d’autonomie. Faire moins ne doit pas être vécu comme une tragédie, mais doit, au contraire, se vivre comme une libération. C’est ce qu’on essaye de montrer dans les conseils et les exemples du livre.
La sobriété repose en partie sur l’autonomie, sur l’autoproduction et l’autoconsommation, est-elle applicable en ville ?
La sobriété s’applique partout. Il est déjà possible de faire un grand nombre de choses pour aller vers un mode de vie plus sobre. Même si ce n’est pas encore suffisant pour atteindre le niveau de sobriété requis pour vivre en respectant les limites planétaires.
« Nous ne sommes pas tous égaux dans nos capacités à passer à la sobriété. »
Après au-delà du clivage ville-campagne, il est évident que nous ne sommes pas tous égaux dans nos capacités à passer à la sobriété. Les villes laissent moins de place à l’autonomie alimentaire mais peuvent ainsi disposer de réseaux d’entraide, de coopératives. Tandis que les campagnes, quant à elles, offrent des opportunités et de l’espace, mais peuvent souffrir de la déruralisation, du dépeuplement, de la dépendance à la voiture et du manque de services publics. La sobriété induit une réflexion sur la manière dont on envisage les villes et les campagnes. Il faut refaçonner les territoires.
D’un côté, à la lecture de votre livre, on a l’impression au travers des conseils prodigués que la sobriété passe d’abord par du comportement individuel. De l’autre, les coups de gueule poussés dans le livre laissent entendre qu’une bonne partie du problème pourrait se résoudre grâce à une plus grande action de l’État. Est-ce qu’une plus grande intervention des pouvoirs publiques permettrait vraiment d’aller dans le sens de la sobriété ?
J’observe que partout en Europe de grandes majorités de citoyens ont compris ces enjeux là et s’en emparent. En France, selon une étude de l’ADEME publiée en début d’année, 93 % des Français aspirent à sortir totalement ou partiellement du mythe de la croissance infinie. Aspirer ne veut pas nécessairement dire faire l’effort pour.
[À lire aussi Faire passer la sobriété de l’échelle individuelle à l’échelle sociétale, un défi à relever]
Néanmoins, il y a bien sûr des contradictions et des contraintes qui rendent difficile de faire un pas complet vers la sobriété. Dans le livre, nous veillons à ne pas nous arrêter à l’échelle individuelle, mais à valoriser le collectif. Car agir seul peut se révéler isolant et décourageant. Cheminer collectivement est plus joyeux, efficace, stimulant et encourageant.
« Quand on aborde la sobriété avec sérieux, il faut s’interroger sur le rapport au travail. »
Quand on voit le rouleau compresseur culturel allant dans le sens d’une remise en cause du modèle actuel, le décalage entre ce qu’on est capable de faire et ce qu’on fait réellement pour la sobriété montre la nécessité d’organiser un dialogue pour repenser es règles économiques. Il convient d’en finir avec le toujours plus. Ce dernier n’a plus sens et il faut apprendre à faire différemment. Par exemple, une fois qu’une entreprise qui fabrique des vélos cargos en a produit assez pour répondre aux besoins fondamentaux, il lui faut alors réorienter son activité vers la maintenance, la réparation et le renouvèlement réguliers à petite échelle des flottes en fin de vie, plutôt que de viser année après années plus de 10 % de ventes . Ainsi, on pourrait redonner du sens aux métiers. Pour y parvenir, il convient au préalable d’arriver à remettre en question le méga rouleau compresseur productiviste.
Une politique et une société de sobriété impliquent-elles de revoir notre rapport aux revenus et au temps, notamment au temps de travail ?
Le rapport au temps est une des questions centrales. D’autant plus qu’on vit dans une société épuisante. Une des promesses du progrès était de libérer du temps pour avoir du temps choisi, elle n’a pas été tenue. Ralentir constitue un enjeu. Se réapproprier le temps permet de gagner en autonomie, de décider ce qu’on produit et pour quel usage. Le mode de vie actuel nous impose l’usage du numérique, une production de nourriture souvent industrielle, de ne pas être en capacité de réparer les objets qu’on utilise pourtant au quotidien.
[À lire aussi Julien Vidal, auteur de Mon métier aura du sens : « aller sur des métiers de sens signifie aller dans des filières prometteuses »]
« Il faut sortir de la vision marchande du travail et revaloriser toutes formes d’activités essentielles pour le vivre-ensemble. »
Quand on aborde la sobriété avec sérieux, il faut s’interroger sur le rapport au travail. En effet, qui dit sobriété dit moins de production marchande et de travail. Toutefois, cela ne signifie pas qu’on aura pas des activités autres et utiles à la société. On oublie trop souvent que de nombreuses activités utiles à la société sont non marchandes. Elles sont effectuées par des gens qui ne sont pas considérés comme des travailleurs. Les retraités par exemple, qui aident leur famille, œuvrent pour les associations ou dans la vie civique. Il faut sortir de la vision marchande du travail et revaloriser toutes formes d’activités essentielles pour le vivre-ensemble, le care, le bien-être, l’autonomie, le partage… Il ne s’agit pas d’oisiveté, mais d’inventer une société qui, en produisant moins, cesse de s’organiser autour des 8 heures quotidiennes de travail consacrées à une activité marchande, qui tend de plus en plus à devenir vide de sens pour un grand nombre de personne. Du moins, c’est ce que semble attester le mouvement de la Grande démission.
Une des critiques récurrentes adressées à la sobriété est qu’elle est un truc de riches et/ou de gens éduqués. Comment sortir de cet écueil ? Comment convaincre de sa pertinence des personnes qui subissent au quotidien des formes de précarité ?
La sobriété, dans sa logique de faire moins, s’applique d’abord aux plus riches dont le mode de vie possède un plus grand impact environnemental. Ils doivent faire le plus d’efforts. La sobriété doit également s’accompagner d’une logique de redistribution. La sobriété est un projet de justice sociale et de justice environnementale.
« Faire moins ne doit pas être vécu comme une tragédie mais comme une libération. »
De plus, si on regarde au niveau international, l’absence de sobriété dans les pays riches conduit à la perpétuation de l’exploitation des ressources des pays pauvres, nuisant ainsi à leurs capacités à être autonomes.
[À lire aussi Sobriété : Et si on s’inspirait de ceux et celles qui la pratiquent au quotidien ?]
Une des données qui m’a le plus frappé en lisant l’ouvrage est que 35 % du budget des ménages allait à l’alimentation dans les années 1960, contre 14 % aujourd’hui. Que nous apprend ce chiffre selon vous ? Comment l’interprétez-vous ?
Ce chiffre montre que quelque chose d’essentiel pour notre bien-être, notre santé et notre bien-vivre est devenu secondaire. Ce phénomène devrait nous alerter sur la place qu’on accorde à l’alimentation surtout que ce processus s’est opéré au détriment des agriculteurs, de l’environnement, des sols, de la santé et des consommateurs. On a aujourd’hui une agriculture industrielle dépendante du pétrole, elle détruit les sols, elle contribue au mal-être des agriculteurs. C’est une profession avec un des taux de suicide parmi les plus élevés en France.
D’un point de vue culturelle aussi, ce chiffre traduit des changements. D’une certaine manière, la croissance se révèle toxique pour des modes de vie sains et pour la joie de vivre. L’habitude de manger des aliments locaux, de prendre le temps du repas et de partager un moment de convivialité s’estompe. Or, la sobriété, c’est avant tout reprendre le temps de retrouver ces moments conviviaux autour d’aliments locaux, qu’on peut avoir contribué à produire, de discuter, d’échanger, de vivre les conflictualités et des moments joyeux.
Quelle serait, selon vous, une mesure de sobriété parmi les plus faciles et efficaces à adopter rapidement ?
Je propose à chacun de faire un pas de côté pour découvrir comment mettre en commun les ressources, apprendre à partager. J’invite tout le monde à apprendre à refaire lien avec son entourage et avec son environnement.
Propos recueillis par Julien Leprovost
Sobriété (la vraie), par Isabelle Brokman et Vincent Liegey, Tana Éditions
À lire aussi sur la sobriété
La sobriété n’est pas synonyme de décroissance, souligne l’Ademe
Consommer responsable, c’est d’abord consommer moins pour les Français

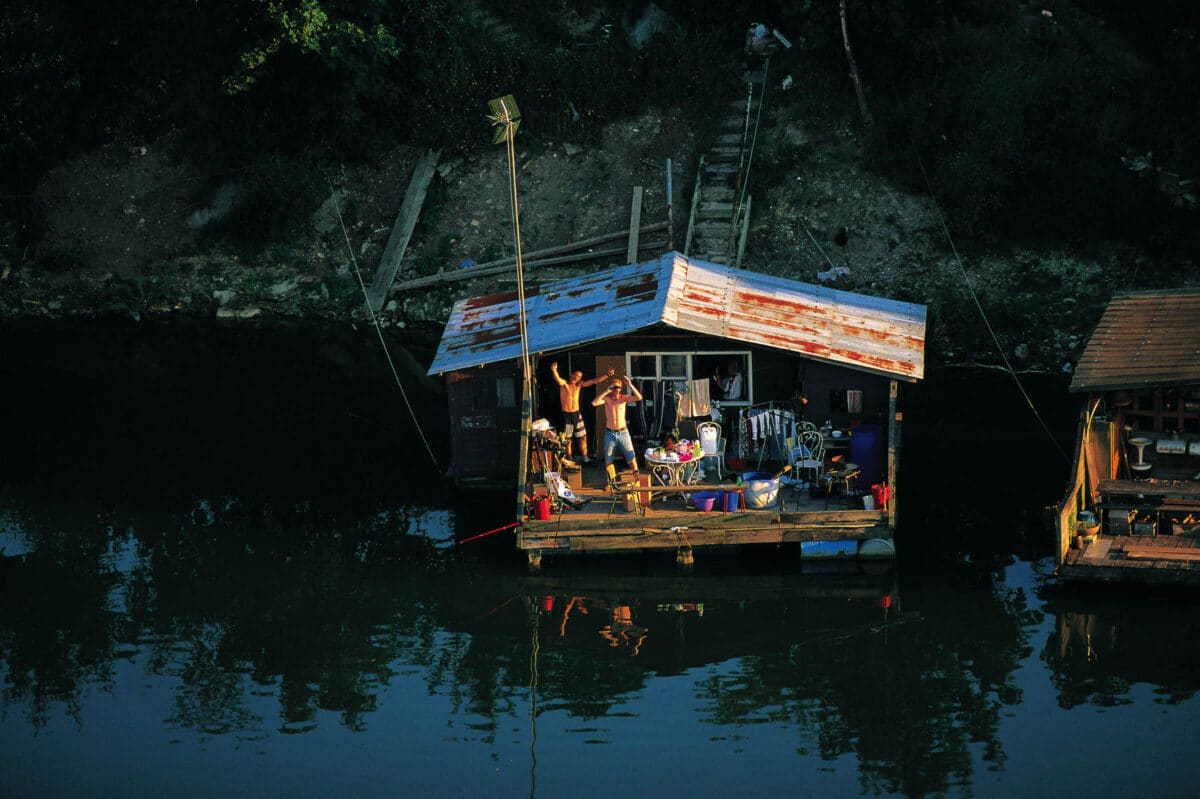
3 commentaires
Ecrire un commentaire
Balendard
Dès 2006 mon ami Georges polytechnicien avait pressenti la dangerosité de la croissance
http://infoenergie.eu/riv+ener/LCU_fichiers/LT-croissance.htm
Mollet-Viéville Ghislain
Loïc Couzineau m’a transmis votre entretien que j’ai apprécié au plus haut point. J’y apporte mon commentaire :
« Dans la vie, bien souvent la perfection est enfin atteinte non pas lorsqu’il n’y a rien à ajouter mais lorsqu’il n’y a plus rien à enlever ».
Cette constatation nous conduit à nous consacrer à une vie débarrassée du tout superflu – et avec elle, l’espoir qu’il est possible de vivre mieux avec moins. Toutefois ce « moins » ne doit pas être transformé en idéologie : « moins » n’est pas « plus » comme le suggère une célèbre formule : « Less is more », « moins » doit être compris comme étant simplement « moins ».
Nous l’avons tous constaté, l’accumulation est une source de désordre. Nous sommes encombrés de produits faussement indispensables, nous croulons sous les faux services, nous sommes soumis à de fausses urgences et à leurs fausses solutions. Tout cela engendre de la confusion mentale.
Sous l’avalanche de ces fausses valeurs, la solution se trouve du coté d’une philosophie du quotidien qui nous entraine vers moins de biens matériels.
Cette philosophie s’oppose à tout ce qui obéit aux excès de la culture de masse qui a pour finalité de nous illusionner pour mieux nous manipuler.
S’en tenir au juste nécessaire, est au contraire reposant et rassurant.
Déjà à son époque, Baudelaire avait décidé d’adopter délibérément une économie précaire. Il habitait dans des appartements très modestes. Il réduisait ses effets personnels au minimum et il utilisait la vie elle-même comme un vaste lieu où tout épanouissement était possible.
Opérer par le « moins » peut donc constituer une modalité d’existence visant à exercer une constante maitrise de soi et à vivre selon des principes qui se recentrent sur l’essentiel.
Opérer par le « moins » aide ainsi à redéfinir ce dont nous avons réellement besoin, cela nous pousse à nous défier de la surproduction surtout quand elle est liée à l’impératif social de la propriété privée.
Dans cet état d’esprit nous le constatons : moins nous possédons, plus nous serons capables de partager.
Et la pratique du « moins » appliquée à notre mode de vie est aussi une forme de résistance à tout de qui est lié au profit et à la rentabilité à tout prix. Plutôt que de posséder quelque chose, il suffit de se contenter de l’utiliser. L’usage n’est alors pas compris comme une valeur en soi mais comme la forme suprême de la vie en commun.
Car ce qui est important c’est ce qui se passe entre les êtres, c’est -à-dire l’interaction sociale avec ses dispositifs de passage et de rencontres.
Mais qu’advient-il aujourd’hui avec les flux tous azimuts proposés sur l’internet. Ces flux nient toutes frontières ou repères fixes. Ils sont sans lois ni directions fiables, sans autorité, sans stabilité ni pérennité. Ils s’accompagnent d’un vaste échange planétaire des savoirs et des compétences. Tout y circule de plus en plus vite, de plus en plus loin et de plus en plus haut.
Avec les effets de la mondialisation, ce qui était loin est désormais au coin de la rue. Ce qui était proche est loin : par exemple quand nous appelons une société pour louer une voiture (en bas de chez nous), il n’est pas rare que notre interlocutrice nous réponde de l’Île Maurice.
La logique de ces réseaux sur l’Internet, a également généré au sein de nos entreprises :
– la disparition des stocks,
– l’essor des ventes en ligne,
– la dématérialisation de l’argent,
– la nette diminution des avoirs matériels.
Le matériel ne disparait pas complètement, mais il est dorénavant dominé par l’immatériel. Ce qui a entrainé l’apparition d’un capitalisme qualifié de cognitif.
Le capitalisme cognitif correspond à une mutation du capitalisme traditionnel vers une économie où les connaissances et les savoirs peuvent constituer des droits de propriété.
C’est une forme nouvelle de capitalisme qui est tout à fait à l’opposé du mode de développement industriel qui vise à accroître la productivité par une réorganisation du travail ne visant qu’à plus de rentabilité et de profits abusifs au détriment de l’humain.
Le capitalisme cognitif n’est plus dominé par la spéculation financière, mais par la créativité et le développement de la force de travail dans de nouveaux rapports sociaux impliquant le partage des droits.
Ce nouveau capitalisme conduit à effacer les contradictions sociales, éthiques et culturelles vécues au sein de la collectivité.
Il accorde plus de valeur au respect de l’être humain et à une économie fondée sur la communication des connaissances.
Il déplace le curseur vers la créativité par l’expérience. Il ne repose plus sur le capital de biens matériels qui sont accumulés outre mesure, mais plutôt sur l’harmonie économique de la production des connaissances en tant que capital intangible.
Le capitalisme cognitif est donc une économie en apesanteur. Il mène à l’économie de l’immatériel.
Et c’est là où je voulais en venir. Dans la création de nos valeurs, l’économie de l’immatériel se caractérise par la suprématie des effets de réseaux sur la productivité des biens matériels qui deviennent secondaires.
Un bien intangible augmente sa valeur en se socialisant, tandis qu’un bien tangible, lorsqu’il est consommé, il est en même temps consumé. Il disparaît et doit être remplacé. Ce qui vit de la matière meurt en même temps que la matière. Alors que ce qui a pour fondement les idées et les concepts vit dans l’éternité.
Lorsque vous avez une idée en tête, vous ne la perdez pas en la communiquant ou en la donnant à d’autres : bien au contraire, vous la renforcez ! Et même : une idée qui ne circulerait pas, serait-elle vraiment une bonne idée ? Elle serait beaucoup plus crédible à partir du moment où elle est transmise, commentée et acceptée.
Dans la représentation que nous nous faisons d’une entreprise traditionnelle, le schéma est simple. Des matières premières sont achetées au départ. L’entreprise crée des produits finis et les vend directement. La productivité, comme les actifs de l’entreprise, lui sont essentiellement internes et matériels
Or, ce n’est plus ce qui prévaut aujourd’hui ! La plupart des entreprises dissocient « activités de conception » et « activités de production ». On s’aperçoit de plus en plus que les activités touchant aux productions d’ordre matériel ont désormais vocation à être sous-traitées en dehors de l’entreprise.
Ce qui reste alors sous la responsabilité d’une entreprise, ce sont des activités socialisées : les droits de propriétés intellectuelles, les connexions et les contacts de l’entreprise avec le monde extérieur. C’est-à-dire, essentiellement, de la conception et du management.
Aujourd’hui, le développement économique d’une entreprise est donc totalement dépendant de l’organisation de ses biens immatériels.
C’est l’immatériel qui l’emporte dans son bilan financier. Toute son économie se rapporte à sa capacité à innover principalement dans le domaine de la communication.
Avec l’art, apparait aussi une nouvelle économie qui est en relation avec des actions collectives où l’œuvre se développe en tant qu’activité et engagement : se mettre à l’œuvre ne signifie nullement produire des objets d’art. Nous sommes ainsi en présence d’œuvres qui ne relèvent plus de l’aura rattachée aux chefs-d’œuvre uniques et sacralisés. Elles n’obéissent pas non plus aux normes de la propriété privée et de son commerce bien souvent fallacieux et indécent.
Le marché de l’art devrait sérieusement s’aligner sur l’économie de l’immatériel et s’intéresser à des biens transmissibles de manière illimitée.
L’éthique pourrait ainsi prendre le relais de l’esthétique de l’art matériel. Et les contours sociaux de l’art deviendraient l’art lui-même (dans le cadre de multiples partages et échanges).
Cette éthique correspondrait à la recherche éclairée d’une perpétuelle redéfinition de l’économie qui serait ajustée à l’art, au sein de réflexions portant sur la valeur et les conditions de pratiques qui seraient ainsi idéalement affirmées en dehors des règles dictées de façon péremptoire, par l’actuel marché de l’art.
Vaste programme !
Ghislain Mollet-Viéville
http://www.revuedeparis.fr/comment-l-art-peut-repenser-leconomie/
Truchot
J ai 65 ans .en retraite .cela fait une quinzaine d années que je suis intéressée par la décroissance. Et le toujours plus m exaspere. Je consomme principalement du local. Légumes produits laitiers .pain .quand je vais au supermarché je suis écœurée de voir toute cette marchandise. Encore plus à Noël. Le civil m a fait prendre conscience de tout ça
.on a pas besoin de tout ça pour vivre ..aujourd’hui Je préfère partager des moments sympas avec des copains .que de m acheter un vêtement ou une vaisselle dernier cri .je préfère faire de belles rencontres
Je compte beaucoup sur les jeunes 30 à 40 ans pour lancer la sobriété
Il y a déjà beaucoup de jeunes qui pensent comme vous
Mon mari et moi nous faisons parti d une AMAP .c est chouette .les jeunes producteurs sont des gens très agréables qui ont un état d esprit qui correspond à mes valeurs ..bon courage à vous pour ce combat ..Beatrice